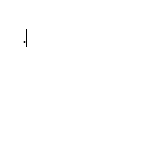Déchiffrer l'énigme humaine (1) par X. Dijon s.j.
1. Les guides de la lecture.
Et si nous disions que nous reprenons tout à zéro ? Nous laissons tomber les derniers potins mondains, les ‘j’aime’ des réseaux sociaux et tous ces messages qui n’ont peut-être pas d’autre effet que de nous maintenir à la surface de nous-mêmes. Et nous plongeons. Où ? En nous-mêmes, dans l’être humain. Pourquoi ? Pour en avoir le cœur net sur ce sujet qui traverse l’existence depuis un certain nombre d’années, et que nous sommes. Il s’agit dès lors, on l’aura compris, de faire de la philosophie. De penser par nous-mêmes pour être un peu plus libres, plus dégagés des langages conventionnels. De chercher à savoir ce que signifie l’énigme humaine. Mais trouverons-nous la réponse ?
Albert Camus, dans Le mythe de Sisyphe, nous introduit en tout cas excellemment à ce genre de réflexion qui se déclenche quand les décors s’écroulent : « Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d’usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil et lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi sur le même rythme, cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le ‘pourquoi’ s’élève et tout commence dans cette lassitude teintée d’étonnement ». Et si ce jour était aujourd’hui, surgissant dans la question étonnée de l’être humain qui s’interroge sur sa destinée ?
Emmanuel Kant, de son côté, dans sa Logique, a divisé plus systématiquement la question philosophique en quatre sous-questions : la première s’interroge sur les outils et les procédures dont nous disposons pour déchiffrer l’énigme : « Que puis-je savoir ? » ; la deuxième cherche en quel sens il faut agir : « Que dois-je faire ? » ; la troisième lève les yeux vers l’avenir : « Que m’est-il permis d’espérer ? » ; la quatrième recueille en synthèse les enseignements précédents : « Qu’est-ce que l’homme ? ». Puisque cette dernière des quatre questions est la nôtre, peut-être faut-il suivre la sage pédagogie kantienne qui commence par la première : que puis-je savoir ?
Le savant et le charbonnier
Car enfin, s’il est toujours possible de tenir des propos péremptoires sur n’importe quel sujet, encore faut-il vérifier si ces affirmations correspondent bel et bien à la réalité. Nous pouvons, certes, écrire des contes de fées ou jouer au poker menteur, mais le souci qui se manifeste dans ces postures-là n’est pas précisément philosophique. A partir du moment où nous voulons en savoir plus sur le mystère humain, il nous faut nécessairement passer par la rigueur qu’impose l’esprit à quiconque entend se soumettre au réel jusqu’au bout. Mais comment savoir si ce que nous disons est vrai ?
Si telle page du présent Pastoralia rappelle que ‘l’église Sainte Philomène remonte au 14ème siècle’, il faut pouvoir vérifier cette affirmation en situant le style du monument, en lisant les inscriptions qu’il contient, en collationnant les documents qui le concernent, etc. Tel est le travail de l’historien déchiffrant le passé dans ses traces, en vue de le présenter à nouveau (le représenter) aujourd’hui. Mais si le même numéro de la revue dit que ‘l’argent ne fait pas le bonheur’, ou que le mariage ne peut avoir lieu qu’entre un homme et une femme’, ou que ‘l’onction des malades confère au fidèle affaibli la force du Christ ressuscité’, comment savoir si ces propositions sont vraies ? Avec quels moyens, et par quels chemins faut-il avancer pour saisir le réel, pour déchiffrer en particulier l’énigme humaine elle-même ? Que puis-je savoir ?
Pour nous aider à cheminer dans cette question, voici que se proposent deux guides, d’allure d’ailleurs bien différente : le savant qui possède la science et le charbonnier qui tient à la foi (la foi du charbonnier, précisément).
Le premier mentor a la partie belle : vous voulez connaître le dernier mot sur l’énigme humaine ? Regardez donc, dit-il, comment s’enchaînent en l’homme les causes et les effets. C’est la même chose que dans la nature : si l’eau se met à bouillir quand on la porte à 100 degrés et si les astres obéissent à la même loi de gravitation que la pomme qui tombe de l’arbre, nous devons donc bien observer les signes que l’être humain présente à nos sens en les prenant comme autant d’effets dont la science doit découvrir les causes. D’où, par exemple, l’embryologie qui étudie le développement de cet être vivant né de la fusion d’un gamète mâle et d’un gamète femelle. Ou la paléontologie qui tente de reconstituer, à partir des fossiles, la longue lignée de l’évolution où émerge, parmi les singes, l’espèce que nous sommes, Homo Sapiens.
Quittant le domaine de la nature physique ou biologique, la démarche scientifique peut entrer dans le champ des sciences humaines, sans abandonner pour autant la volonté d’expliquer les effets qui tombent sous les sens par des causes exprimées en forme de lois. Ainsi, en psychologie, le chercheur observe les liens qui s’établissent entre les sollicitations adressées à tel ou tel sujet (dûment caractérisé par son âge, son sexe, son éducation, etc.) et les réponses que donne ce sujet en réaction à ces stimuli, de manière à établir des constantes qui permettent de mieux connaître le psychisme si complexe des humains. Même chose en sociologie mais, cette fois, au niveau des groupes, pour parvenir à décrire les stratégies qui se mettent en place dans les relations collectives sous la contrainte de la pression sociale.
Mais toutes ces explications déplient l’énigme humaine comme on étale une carte routière sur la table : l’homme vient d’ici, dit-on, et il va là-bas, au gré des facultés dont il dispose et des circonstances qu’il rencontre. Mais qui ne voit que c’est de l’extérieur que s’opèrent ces descriptions ? Or l’être humain dépasse, en son fond, cet assemblage de structures et de fonctions, que la démarche scientifique expose sans doute avec de plus en plus de précision au fur et à mesure de ses progrès, mais qui ne cernent tout de même pas le cœur de la question. Car l’être humain connaît en lui-même cette faculté de s’interroger sur le tout de son existence, sur son sens, sa signification, sa direction.
Or c’est ici que se présente l’autre guide, mais est-il meilleur ? Le charbonnier prend le relais ou, -plus souvent-, le contrepied du premier puisqu’il pense avoir, lui aussi, la solution recherchée. Vous voulez savoir qui vous êtes ? Ouvrez la Bible ! L’homme a été créé par Dieu au sixième jour ; le Christ ressuscité nous ouvre le paradis ; il ne faut pas chercher à comprendre le mystère de la Trinité, puisqu’il s’agit précisément d’un mystère ; et, de toute façon, le pape est infaillible. Voilà donc l’énigme résolue.
On imagine sans peine que, entre les deux guides, l’entente ne sera pas cordiale, le premier accusant le second d’être demeuré hors de la rationalité, dans l’âge mythique des contes qui rassurent les enfants ; le second reprochant au premier de se contenter d’un matérialisme plat qui fait fi de la dimension spirituelle de l’existence humaine. Or, sans vouloir tout mélanger, nous ne pouvons pas vivre ainsi écartelés entre ces deux sources diamétralement opposées qui prétendraient nous dicter de l’extérieur la vérité sur l’homme. D’où l’urgence du recours à la philosophie qui reprend la question, cette fois, de l’intérieur : « Qu’est-ce que l’homme ?»
Déchiffrer l'énigme humaine (2) par X. Dijon s.j.
2. Corps et âme
Bonne année, bonne santé, répétons-nous à nos amis le Jour de l’An. Mais quelle santé ? Nous songeons, bien sûr, à la santé du corps, définie par le chirurgien René Leriche comme la vie dans le silence des organes : oui, que nos jambes nous portent sans gémir ! Que notre estomac absorbe sans protester ce que nous lui donnons à digérer ! Que rien donc, en notre corps, ne nous distraie, par ses douleurs, ses éruptions, ses gonflements, etc., de la vie que nous entendons mener. Mais nous songeons peut-être aussi à la santé de l’âme, d’ailleurs dans les deux sens qu’indiquent les termes grecs : la santé de la psychè sur laquelle se penche le psychologue et celle du pneuma à laquelle l’accompagnateur spirituel prête son écoute. Le premier cherche à démêler les fils dans lesquels le sujet s’est empêtré pour trouver avec lui, dans l’enchevêtrement de ses relations passées et présentes, les causes de l’angoisse, de la dépression ou de l’exaltation qu’il connaît. Le second attire l’attention de la personne sur la fine pointe de son âme dans sa relation à l’Esprit : d’où vient, par exemple, qu’elle serait agitée, tiède, sans espérance et sans amour, comme si elle était séparée de Dieu ?
S’il est vrai que les distinctions s’imposent entre la médecine, la psychologie et la spiritualité, il serait tout de même difficile de couper au couteau les trois types de santé cernés par ces trois approches. C’est que l’être humain est un, dans la trinité de sa composition : corps, âme, esprit. Ainsi, la maladie physique peut affecter l’humeur du malade comme sa prière ; le trouble psychique retentit sur le corps, ainsi que l’affirme la médecine psychosomatique ; le lien à Dieu assume, sous le mode, soit de la révolte, soit du consentement, les troubles du corps ou de l’âme. Mais comment comprendre, en philosophie, ce caractère composite de l’énigme humaine ?
L’attelage disparate
Platon lui a donné la réponse, regrettable dit-on, du dualisme puisque, pour lui, l’âme est jetée dans le corps comme dans une prison, soumise alors à la connaissance seulement sensible que les sens corporels lui imposent. Il importe donc, poursuit le disciple de Socrate, de se dégager, par l’ascèse philosophique, de ce royaume des ombres pour accéder à la connaissance essentielle du réel que l’on trouve dans la réflexion de l’esprit. Vue à partir de notre époque, une telle approche nous semble sans doute dangereuse car elle introduit une division, dans l’être humain lui-même, entre son corps et son âme ; elle compte cependant l’incontestable mérite de montrer que la personne porte en elle plus que son corps.
La grande énigme, en effet, est celle de la mort. La personne qui, jusque-là, était porteuse de vie perd le souffle, la couleur et le mouvement ; elle devient raide, blanche, inerte. Que s’est-il donc passé ? Les philosophes matérialistes répondront qu’il s’est passé ce qui se passe pour tout autre animal : la mort a irrémédiablement mis fin à cet exemplaire de l’espèce. D’ailleurs, aujourd’hui encore, de brillants esprits scientifiques affirment, au vu de la réalité qui tombe sous les sens : il n’y a rien au-delà de la mort. Platon, pourtant, refuse cette conclusion, précisément au nom des expériences spirituelles dont l’homme est capable durant sa vie : l’effort philosophique, dégagé des passions terrestres, parvient à la contemplation de l’essence des choses, de leur bonté, de leur beauté. Il n’est dès lors pas possible que l’âme, capable d’une connaissance supérieure au monde physique (métaphysique donc), se corrompe de la même manière que le corps : elle est immortelle !
Il vaut la peine d’entretenir à l’intérieur de soi la vertu d’étonnement devant cette puissance spirituelle que le philosophe païen Platon a découverte dans l’être humain. L’âme donne vie au corps, mais elle ne meurt tout de même pas avec lui, car elle vient d’un Ciel qui transcende le monde sensible, et elle y retourne à la fin de son parcours terrestre.
Malgré tout, il reste à comprendre ce curieux attelage dépareillé, d’un corps périssable emprisonnant une âme qui ne l’est pas. Aristote, disciple de Platon, reprend la question en accentuant la synthèse humaine. Il parle de l’union substantielle : l’âme fait corps avec le corps, lui donnant sa forme spécifique parmi tous les autres êtres animés. Alors que la matière est pure potentialité, l’âme la traverse pour la faire passer à l’acte : ainsi l’homme vit-il d’une vie non seulement végétative ou animale mais proprement humaine, capable d’intelligence, de réflexion et de vertu.
Du même coup, la question se redouble, des deux côtés de l’étrange union : d’où vient qu’une matière si immergée dans la nature biologique soit capable de réflexion et de langage pour percer les secrets du réel et s’interroger sur le bien à faire ? A l’inverse, comment se fait-il que les subtilités de l’esprit et de la liberté soient aussi indissociablement associées aux lourdeurs du corps ? Dans l’histoire de la philosophie, la tentation est grande de trancher la question en ne gardant qu’un seul cheval de cet attelage si mal assorti.
Puisque l’homme se définit par l’esprit, c’est dans la substance pensante et non dans la substance étendue que se trouve sa subjectivité la plus profonde, conclut René Descartes, au terme de sa méditation philosophique : « je pense, donc je suis ». Mais en face de cet idéalisme, le matérialisme donne une réponse diamétralement opposée : c’est de la matière elle-même qu’émerge, -matière encore-, le cerveau capable de parole. Comme le dit Jean Rostand, dans ses Pensées d’un biologiste (1967) : La seule chose dont je sois vraiment sûr, c’est que nous sommes de la même étoffe que les autres bêtes; et si nous avons une âme immortelle, il faut qu’il y en ait une aussi dans les infusoires qui habitent le rectum des grenouilles.
Son propre être
Encore une fois, comment mettre ensemble cette subjectivité de l’âme, du je pense, et cette objectivité du corps apparemment de même étoffe que l’animal ? Blaise Pascal s’étonnait déjà de cette condition : L’homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature ; car il ne peut concevoir ce que c’est que corps, et encore moins ce que c’est qu’esprit, et moins qu’aucune chose comme un corps peut être uni avec un esprit. C’est là le comble de ses difficultés, et cependant c’est son propre être (Pensées, éd. Brunschvicg, 72). Pour nous mettre sur la voie de la réponse, peut-être est-il utile d’appliquer à notre composé humain les trois personnes verbales apprises à l’école primaire : Je, Tu, Il.
Le Je, c’est tout à la fois la subjectivité, l’âme, la liberté qui réfléchit sur ses actes, le moi, l’esprit qui se pose des questions sur le réel. Le Il représente l’objectivité, le corps dans son extériorité, son poids, sa taille, ses organes, le soi. Comment rendre compte du fait que le Je ne se laisse saisir en aucune manière en dehors du Il (n’a-t-on pas dit que l’homme pense avec ses pieds ?) et que le Il corporel n’est jamais un pur objet, transi qu’il est, de part en part, par le Je de l’âme ? Puisque l’homme n’a pas pu produire de lui-même cette union substantielle, peut-être devons-nous chercher la clé ailleurs, dans le Tu que les grammairiens placent entre le Je et le Il. C’est parce que l’être humain serait donné à lui-même par un Tiers (un Tu) qu’il pourrait commencer à comprendre l’énigme qu’il est à lui-même comme indissociable alliance de Je et de Il.
Déchiffrer l'énigme humaine (3) par X. Dijon s.j.
3. Homme et femme
Décidément, l’énigme humaine ne se laisse pas facilement déchiffrer. Rappelons-nous : au départ, deux guides se proposent pour en faire la lecture, la science et la foi, mais comment tenir ensemble les propos qu’elles nous tiennent ? Puis c’est le composé humain lui-même qui se dédouble, corps et âme : entre le charnel et le spirituel, faut-il choisir ? A présent, voici le couple, homme et femme : dualité encore ? Il est vrai que la donnée sexuelle a coupé l’humanité en deux, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Pourquoi ? Deux réponses (au moins) sont possibles.
Une double réponse
Une philosophie quelque peu naturaliste n’y verra pas grand mystère : dans la longue chaîne de l’évolution, la reproduction sexuée permet une meilleure diversité des gènes transmis d’une génération à l’autre, puisque chaque individu de l’espèce reçoit la moitié du patrimoine chromosomique de chacun de ses deux géniteurs. Il s’imposait donc, disent les savants, que l’animal humain, qui a conquis la terre entière, naquît de la rencontre d’un mâle et d’une femelle.
Or en réaction à cette lecture qui plonge la sexualité humaine dans les logiques de la biologie animale, surgit une protestation existentielle qui fuit les corps pour mieux retrouver l’âme. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la théorie du genre (en anglais gender theory). Théorie pas toujours simple à saisir mais que nous pouvons définir ici par la volonté qu’exprime le sujet humain, homme ou femme, de ne pas laisser sa liberté s’engluer dans le déterminisme des corps : femme, elle peut devenir « homme » – ou l’inverse : homme, devenir « femme » – et se comporter comme tel(le) dans l’ensemble de ses relations. C’est que, pour affranchir les humains (en particulier les femmes) des rôles sociaux qu’on leur faisait jouer autrefois au nom de leurs prédispositions naturelles, il faut nier une telle nature : la différence sexuelle ne reçoit sa signification que de la décision prise à son égard par chaque sujet. En ce sens, l’homosexualité ou la bisexualité sont aussi légitimes que l’hétérosexualité.
La double réponse, on le voit, ressemble à une déchirure. D’un côté, l’homme et la femme doivent se comprendre eux-mêmes selon la fonction naturelle que leur assigne leur architecture corporelle, en vue de la génération ; de l’autre, ils doivent se dégager, par la culture, de toute contrainte qui leur serait imposée du fait d’appartenir à tel sexe ou à tel autre. Mais où donc se trouve la lecture médiane qui permettrait de recoudre la déchirure ?
On peut comprendre que les femmes aient souhaité se libérer du carcan social dans lequel les enfermait, par exemple, le slogan des 3 K, formulé par l’empereur Guillaume II : Kinder (les enfants), Küche (la cuisine), Kirche (l’Eglise), et qu’elles aient voulu investir les champs réservés jusqu’ici aux hommes : la conduite des affaires publiques, la direction d’entreprise, le cadre académique de l’université… Une grande mobilisation s’est en effet mise en branle pour lutter contre les discriminations commises à l’égard des femmes, et que révélaient, depuis trois ou quatre décennies, les études de genre, lesquelles cherchent à débusquer, dans tous les endroits de l’histoire, du savoir et de l’action, les situations où un genre (féminin en l’occurrence) est mis en état d’infériorité par rapport à l’autre. Mais attention ! Ces études de genre ne doivent pas être confondues avec la théorie du genre. Car il est parfaitement possible de lutter contre les discriminations dont les femmes font encore l’objet sans adhérer pour autant à l’idéologie qui refuse de donner à la sexualité charnelle une détermination quelconque dans la conduite humaine.
Reprenons la question : à quel endroit devons-nous donc nous placer pour comprendre la raison de la dualité homme/femme ? Dans la ligne de l’évolution des espèces comme le fait l’approche biologisante qui place au départ la lignée animale (sans référence à l’esprit) ? Ou dans le surgissement de la liberté pure qui fait valoir son identité strictement individuelle (sans référence à la chair) ?
Un autre point de départ
Mais peut-être existe-t-il une troisième lecture, médiane celle-là, qui prend pour point de départ de la réflexion la propre origine de la personne qui réfléchit. Car en se retournant sur sa naissance à elle, la personne constate qu’elle est née de la dualité sexuelle puisque c’est nécessairement l’union d’un homme et d’une femme qui l’a fait venir à l’existence. Cet humble fait de l’engendrement sexué n’offre-t-il pas le point de départ le plus sûr pour entamer la lecture de la dualité sexuelle, et donc pour situer à leur juste place les deux lectures précédentes ?
Car il est vrai que cet engendrement humain a été précédé de toute l’évolution des espèces animales, mais le sujet qui pose aujourd’hui la question philosophique (portant sur la dualité sexuelle) est, par définition, un être d’esprit. Puisque ce sujet provient d’un homme et d’une femme qui ont redoublé leur union charnelle par un acte typiquement humain de parole, il est radicalement insuffisant de prétendre rendre compte de la sexualité humaine en la rapportant seulement à la reproduction animale. Réciproquement, si l’être qui s’interroge sur son genre veut bien revenir sur sa propre naissance, il verra que sa liberté, si fascinante qu’elle soit, ne trouve pas son origine en elle-même mais que son surgissement n’a été rendu possible que par la réalisation d’une condition fondamentale, à savoir la soumission de son père et de sa mère à l’altérité – et à l’union – des sexes. Hors de cette reconnaissance, le sujet manque sa propre insertion dans la condition humaine, dans le temps, dans l’histoire.
En prenant l’existence même du philosophe que nous sommes (vous et moi) comme point de départ de notre réflexion sur la différence homme-femme, devons-nous en déduire que cette différence ne trouverait son sens que dans le don de la vie ? Une telle conclusion réveillerait sans doute le spectre d’une réduction de la sexualité à la procréation et nous reconduirait peut-être à la réponse naturaliste, que nous avons pourtant jugée insuffisante. En réalité, sans lâcher le lien – qui s’impose par l’évidence – entre le don de la vie et l’union hétérosexuelle, il importe de donner à cette vie son caractère proprement humain, c’est-à-dire porteur de symbole. Le corps dit l’âme, en surcroît de la seule biologie, comme nous l’avons vu dans la réflexion précédente sur l’âme et le corps (Pastoralia, janvier 2016), car il vise la rencontre des personnes. Réciproquement, l’âme n’a pas pu se dire autrement que dans l’échange des corps qui ont permis, grâce au féminin et au masculin de leurs différences, que viennent à l’existence des êtres de chair et d’esprit. Accepter la radicale altérité de l’homme et de la femme, quels que soient d’ailleurs les rôles respectifs qu’ils occupent dans la société, c’est admettre que l’énigme humaine ne se résoudra que dans la communion. Une fois de plus, il faut donc tout tenir ensemble : la convenance charnelle de l’homme et de la femme comme seule origine de la vie, et la symbolique spirituelle qui a reconnu l’origine de toute vie dans la parole d’amour.
.
Déchiffrer l'énigme humaine (4) par X. Dijon s.j.
4. Liberté et égalité
L’être humain connaît sa première socialisation dans la famille puisque sa naissance provient de l’union d’un homme et d’une femme, lesquels assument, en principe, l’éducation de l’enfant qu’ils ont engendré. Or, si importante qu’elle soit en tant que fondement de la société, la famille n’est pas l’horizon dernier de la vie, car l’homme doit encore accéder à la Cité, c’est-à-dire à la dimension proprement politique de son existence. Aristote évoque à cet égard, dans son Ethique à Nicomaque, une distinction intéressante entre la justice politique, qui règne au sein de la Cité, et la justice domestique, qui organise les relations à l’intérieur de la maison.
Alors que, pour le philosophe grec, la justice politique se joue entre citoyens libres et égaux, la justice domestique travaille sur des bases qui ne sont pas exactement celles de la liberté ni de l’égalité. C’est que, à la maison, les enfants ne sont pas vraiment séparés du père ; ils ne sont donc pas situés dans une relation d’égalité avec lui ; soumis à son autorité, ils ne sont pas libres non plus. La justice, ici, repose sur le père qui devra prendre soin de ses enfants comme de lui-même puisque, précisément, ils sont une part de lui-même. Mais le but de l’éducation consiste bel et bien à conduire ces enfants hors de la maison (en latin e-ducere signifie : conduire hors de) pour qu’ils deviennent des citoyens autonomes, séparés les uns des autres, libres donc, et égaux entre eux, à l’ombre de la justice politique.
Le débat
Dans la suite de l’histoire, les discussions continueront bon train sur ces sujets, par exemple en corrigeant les deux grandes inégalités que maintenait la Grèce antique : à la maison, la femme doit trouver sa place égale de mère aux côtés du père, sans plus être traitée comme une mineure ; dans la cité, les esclaves ne doivent plus être considérés comme des êtres inférieurs qui n’auraient pas le droit de participer au débat public. Cela dit, comme il est difficile de tenir ensemble la liberté avec l’égalité !
La liberté entre dans la définition de l’être humain comme tel : alors que l’animal est déterminé par ses instincts qui le conduisent à adopter tel ou tel comportement, en vue de se maintenir en vie et de se reproduire, l’homme pose des choix dont l’énergie s’alimente sans doute à ses propres instincts, mais dont l’orientation est déterminée par le but que sa raison estime bon. Une cité humaine n’est pas comparable à une fourmilière régie par les lois de la biologie, car, en son autonomie, l’homme se donne à lui-même ses normes. Mais quelles normes ? Suffit-il de dire que la liberté des uns ne peut rencontrer comme limite que la liberté des autres ? Telle fut, on le sait, l’option prise par les révolutionnaires de 1789 qui voulaient se libérer des carcans politiques et économiques imposés par la société hiérarchisée de l’Ancien Régime.
Or cette liberté que le libéralisme a débridée n’a pas fait que des heureux : les rapports contractuels noués en toute liberté entre le propriétaire des moyens de production d’une part, le prolétaire qui ne disposait que de sa force de travail d’autre part, ressemblaient en effet trop bien à la position du renard libre dans le poulailler libre. D’où la réaction du parti de l’égalité (socialisme, démocratie chrétienne) en vue de ramener les libertés à une considération plus fondamentale, à savoir la dignité de tous les êtres humains ; les y ramener au moyen de lois qui encadreraient plus strictement les appétits des citoyens qui détiennent, au titre de la richesse ou du savoir, une plus grande part de pouvoir sur autrui. La question est-elle réglée pour autant ? Pas nécessairement.
Car l’égalité peut, à son tour, causer des ravages ainsi que l’ont montré, par exemple, les dictatures marxistes. Aux fins de s’assurer que tous les travailleurs bénéficieront du fruit de leur travail, le Parti s’autoproclame seul représentant du peuple, habilité ainsi à imposer sa propre ligne de conduite dans tous les domaines de l’économie, de la politique et de la culture : toute autre voix, considérée comme déviante, est lourdement condamnée : on ne badine pas avec la dictature du prolétariat.
Il semblerait donc à la fois nécessaire et impossible de tenir ensemble les extrêmes de la liberté et de l’égalité. La liberté individuelle, laissée à elle-même, creuse les inégalités entre les sujets puisque les puissants disposent librement de tous leurs moyens pour accroître leur patrimoine économique, politique et culturel, tandis les pauvres et les faibles ne gardent que la liberté de dépérir. A l’inverse de cette dérive égoïste, l’égalité collectiviste vire, elle, à la jalousie puisqu’elle étouffe toutes les manifestations de la personne libre et créatrice, en rabotant toutes les identités personnelles. Voilà un dilemme – liberté sans égalité ou égalité sans liberté – dont la solution est apparemment trouvée dans la superposition de ces deux courants, amenés ainsi, de gré ou de force, à se corriger réciproquement.
La superposition
A l’échelon national, par exemple, nos démocraties connaissent l’alternance des gouvernements, tantôt plus libéraux, tantôt plus socialistes. A l’échelon mondial, l’ONU proclame l’indivisibilité des droits de l’homme, c’est-à-dire l’obligation de prendre en compte à la fois les droits civils et politiques, qui découpent un espace de liberté autour de chaque individu (libre de penser, de s’exprimer, de posséder, etc.), et les droits économiques, sociaux et culturels qui entendent garantir à tous les humains les moyens de leur existence (logement, soins de santé, instruction, etc.) pour qu’ils connaissent entre eux un minimum d’égalité.
Mais, par-delà le pragmatisme, le philosophe se demande sur quoi se fonde cette superposition. Est-ce uniquement sur le Contrat social, inventé au Siècle des Lumières pour expliquer l’état social à partir d’un état (non-social) de nature ? Ne serait-ce pas plutôt sur la réalité familiale elle-même ? Expliquons-nous.
Dans l’état de nature, on le sait, les individus sont tous égaux du fait de jouir de toutes les libertés. Or comme un tel état est invivable puisqu’aucune autorité n’est là pour trancher leurs conflits, les sujets décident de renoncer à l’exercice complet de leurs droits pour passer entre eux un Contrat social qui instituera une autorité capable de leur enjoindre une norme commune. Cette norme, bien sûr, ira le plus loin possible, tant dans le respect des libertés dont les citoyens jouissaient en leur état de nature, que dans la promotion de l’égalité de tous les partenaires au Contrat social. Mais fallait-il imaginer cette convention artificielle pour expliquer la genèse de la société politique, alors que la famille offre d’emblée un état de nature immédiatement social ?
Le lien social, en effet, ne dépend pas d’une décision des humains en leur raison ; ce lien les précède puisque, nous l’avons dit, l’homme naît de l’union de ses parents et se retrouve d’ailleurs bientôt entouré de frères et de sœurs. Certes, l’homme n’a pas explicitement voulu vivre dans une famille, mais c’est là qu’il apprend, sous la férule de l’autorité parentale, comment la liberté se conjoint à l’égalité : liberté suffisamment fraternelle pour se tourner vers autrui, considéré comme égal en dignité ; égalité suffisamment fraternelle pour permettre à autrui de déployer l’identité de sa liberté… D’ailleurs, les Français le savaient déjà : pour nouer le projet politique sans égoïsme et sans jalousie, il faut ajouter aux deux mots Liberté, Egalité, le troisième Fraternité.
Déchiffrer l'énigme humaine (5) par X. Dijon s.j.
5. Le mal et la mort
Apparemment, aucun thème n’est plus éloigné de la philosophie que le mal et la mort. Quelle raison trouver, en effet, dans l’absurdité d’une calamité naturelle qui tue toute une foule, ou d’un enfant rendu handicapé à vie par un malheureux accident survenu à sa naissance ? Plus grave encore : comment rendre compte d’attitudes morales aussi négatives que la méchanceté perverse ou la froide trahison ? Alors que, tout au long de son histoire, la philosophie cherche à rendre compte de la destinée humaine dans la lumière de l’esprit, que peut-elle dire de sensé au bord de la tombe ou devant les ténèbres de l’âme ? Pourtant, ce sont précisément ces expériences contrariantes qui forcent la réflexion à creuser davantage l’énigme humaine. Mais plutôt que de chercher une impossible explication du mal, elle se met en quête de la sagesse, par exemple chez les Tragiques grecs ou dans les enseignements du Bouddha.
Sagesse grecque ou bouddhiste
La voie grecque aborde le malheur de l’homme comme une part inhérente à sa condition. Oui, la vie est tragique et les hommes, comme aveuglés sur eux-mêmes, sont le jouet du destin, aveugle lui aussi, mais l’important est qu’ils en aient pris conscience et qu’ils admettent cette condition-là. Car leur révolte contre la limite proprement humaine rendrait leur condition pire encore. Puisque tout le mal, finalement, vient de la démesure, le remède consiste dans la mesure : rien de trop ! Les Stoïciens ont honoré cette sagesse en exhortant leurs disciples, d’abord à s’abstenir de toutes les passions qui dépendent d’eux et qui pourraient troubler leur âme, ensuite à supporter (stoïquement, dit-on) tous les événements qu’ils ne peuvent maîtriser et qui les contrarient. De la sorte, ils connaîtront la tranquillité de l’esprit qui parvient à épouser l’ordre rationnel de la nature
Du côté du bouddhisme, on trouve certains traits semblables à ceux-ci mais dans une métaphysique du vide. D’où vient la souffrance des hommes sinon de leurs désirs inassouvis ? Ils veulent détenir la gloire ou la richesse ; ils s’emportent contre leur voisin… ; mais que font-ils en agissant ainsi ? Ils tombent dans l’illusion de croire que le monde a de la consistance, et qu’eux-mêmes ont une personnalité. En réalité, toute existence est comme la vaguelette soulevée par le passage du canot : elle s’évanouit bien vite… Pourquoi donc vouloir posséder des biens ? Pourquoi même vouloir être soi ? De tels désirs construisent une « réalité » qui n’existe pas (puisque l’existence est vide), du même coup, ces aspirations font souffrir. Pour éviter la souffrance, il faut donc passer par l’extinction du désir : ne rien attendre de la vie, de telle sorte qu’aucune déception ne pourra plus atteindre le sage qui aura su se détacher de tout.
Par la profondeur et la noblesse de leurs vues, ces deux premières voies – de la tragédie grecque et de la sagesse bouddhiste – montrent en tout cas que l’homme ne peut réfléchir sur le mal et la mort qu’en s’inscrivant lui-même dans la perspective qu’il adopte plus largement sur le sens global du réel : une nature transie de raison à laquelle il s’agit de se conformer, chez le stoïcien ; un Rien dans lequel il faut s’éteindre, pour le bouddhiste. Car la contradiction que le mal ou la mort infligent à sa raison oblige l’homme à déployer, sur lui-même et sur le monde, une rationalité plus profonde : qui est-il, lui, et qu’est-ce que le monde, pour qu’il lui arrive de subir le mal et la mort en ce monde ?
Etre-pour-la-mort
Peut-être est-ce dans ce sens-là que Martin Heidegger parle de l’homme comme de l’être-pour-la-mort, en contraste, par exemple, avec l’animal. Certes, la bête peut connaître la douleur et la disparition, mais la bête ne meurt pas : elle finit, subissant par-là la loi immémoriale de la nature qui fait se succéder les générations sur la roue de la vie. L’être humain, de son côté, subit sans doute la même loi, mais pas de la même manière car il sait d’emblée, contrairement à l’animal, que la mort est sa dernière possibilité humaine. Il se sait mortel. Le voici donc amené, par cette conscience, à vivre une existence authentique, attentive à l’être du réel et non plus engoncée dans le fonctionnement technique des objets. Ainsi la mort questionne-t-elle le sujet : elle déchire le tissu trop lisse de son existence pour interpeller son existence elle-même : en vue de quoi es-tu là ?
Mais puisqu’il s’agit d’élucider le tout de l’existence pour parvenir à rendre compte du mal qui contrarie l’existence elle-même, peut-être faut-il viser plus haut que l’humain, décidément trop petit pour rendre compte de cet aspect douloureux de sa propre énigme ?
Ecartons d’abord d’emblée la solution manichéenne qui consiste à poser un Dieu du Mal en rival d’un Dieu du Bien, car cette dichotomie ne rejoint pas le drame de la liberté humaine qui cherche précisément à penser en même temps ces deux contraires que sont Dieu et la contradiction ressentie comme un mal. Posons donc la question de savoir en quel sens va le lien qui relie Dieu et le mal. A vrai dire, les deux sens sont possibles.
Dieu et la contradiction
En déployant sa Critique de la raison pratique, Emmanuel Kant se voit tenu de postuler l’existence de Dieu à partir de l’expérience morale concrète. D’une part, en effet, l’être humain entend en sa conscience l’impératif de considérer tout être humain avec le respect qui lui est dû ; d’autre part, chaque sujet connaît aussi, en sa sensibilité propre, une aspiration au bonheur. Or les deux exigences ne vont pas nécessairement de pair puisque le respect de la loi morale n’assure pas toujours, loin s’en faut, le bonheur des justes : les cœurs droits sont souvent méprisés, alors que les méchants jouissent de toutes les faveurs de ce monde. Kant conclut : il faut, non pas prouver l’existence de Dieu (tâche impossible à l’esprit humain, dit-il), mais admettre son existence, car cette Supposition permet de réconcilier l’exigence proprement éthique du respect d’autrui avec l’aspiration de chacun au bonheur. Seul Dieu, en effet, Créateur du ciel et de la terre, peut récompenser par le bonheur le respect de la loi morale dont la source n’est autre que Lui-même.
Mais alors que la souffrance du juste postule l’existence de Dieu chez Kant, elle peut, à l’inverse, conduire à son rejet. Pour Albert Camus, par exemple, l’absurdité d’une telle souffrance conduit à la révolte, comme le laisse entendre le docteur Rieux dans La peste : « puisque l’ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu’on ne croie pas en lui et qu’on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se tait ».
« Dieu doit exister », dit l’un ; « il vaut mieux qu’il n’existe pas », dit l’autre : qui a raison ? A ce point de la réflexion, il serait puéril de faire gagner un auteur contre l’autre. Dans la question du mal et de la mort s’est glissé, en effet, tout l’engagement spirituel de l’homme pour ou contre Dieu. Serait-ce en ce rôle de révélation que se cacherait le sens dernier de la contradiction qui survient à l’homme ? Une conclusion s’impose en tout cas : cette contradiction, il nous faut la porter ensemble.
Comme l’écrit le Dr Catherine Dopchie (LLB 4 janv. 2016) à propos des grands malades : « Etre à l’écoute, entendre avec le cœur, partager les émotions, ne veut pas dire avoir réponse à tout… La fraternité permet parfois au souffrant de voir éclore en lui une lumière nouvelle, car dans ces détresses, la solution naît de l’intérieur, elle ne s’impose pas de l’extérieur ».
Déchiffrer l'énigme humaine (6) par X. Dijon s.j.
6. Dieu
A première vue, on pourrait dire que la question de Dieu relève de la théologie et non pas de la philosophie puisque la théologie, comme son nom l’indique, énonce le discours sur Dieu, tandis que la philosophie recherche la sagesse (humaine). Voilà, dirait-on, une saine division du travail.
En réalité, cette répartition est trompeuse puisque, d’une part, les théologiens ne s’occupent pas seulement des choses du ciel : c’est que la foi en Dieu implique toute une intelligence du monde et toute une éthique de l’homme ; d’autre part les philosophes, pour rendre compte de ce qu’est l’être humain, reconnaissent la nécessité de se tourner en pensée vers une Réalité qui dépasse l’humain lui-même.
En Occident, les Grecs furent les premiers à le dire.
La réflexion des Grecs
Pour Platon, par exemple, l’âme possède une telle qualité spirituelle qu’elle est capable de percevoir, par-delà les objets sensibles, l’être lui-même en sa Bonté ; elle peut reconnaître dans un univers qui dépasse la physique (méta-physique, donc) l’équivalent de ce qu’est le Soleil dans le monde de la nature, à savoir l’Idée du Bien. Nous qui sommes enchaînés dans la caverne où les choses ne sont encore que des ombres, voici que la réflexion philosophique nous purifie jusqu’à nous permettre de contempler la lumière divine de l’Etre…
Le disciple de Platon, Aristote, réfléchit quant à lui à partir du mouvement : si tout l’univers bouge – la plante pousse, l’animal se déplace, l’homme mûrit –, passant ainsi de la simple potentialité (la puissance) à l’effectivité (l’acte), c’est qu’il doit exister un Acte qui, du fait d’être, depuis toujours et pour toujours, pleinement lui-même, ne contient en lui aucune potentialité : l’Acte pur, appelé aussi Moteur immobile puisqu’il ne bouge pas (il est parfait), mais il attire tout l’univers qui se met en branle vers lui.
De telles réflexions, dites de théologie naturelle, partent de la profondeur de l’expérience humaine, dans le domaine de la connaissance ou de l’action, pour tenter d’en rendre compte jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au point où l’homme reconnaît qu’il est dépassé par une réalité qu’il ne peut saisir, pas même dans un temple.
L’apôtre Paul, dans son discours à l’aréopage d’Athènes, appréciera à sa juste valeur cet effort des philosophes grecs, en particulier des Stoïciens, qui tâchent de rejoindre Dieu dans son essence proprement spirituelle : « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme… À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu’ils…le cherchent et, si possible, l’atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Ac 17, 24..28).
Le relais des chrétiens
Lorsqu’ils ont accueilli la révélation que Dieu fait de lui-même dans la personne de Jésus de Nazareth, les premiers chrétiens n’ont pas pour autant envoyé aux oubliettes les tentatives philosophiques antérieures, pas plus d’ailleurs qu’ils n’ont rejeté les récits et les prophéties de l’Ancien Testament comme si les Juifs ou les Grecs n’avaient plus rien d’intéressant à leur dire. Au contraire : pour un chrétien, il fait partie du mystère de Dieu de faire précéder, tant par l’alliance avec le peuple hébreu que par la recherche de la raison en quête de sagesse, la révélation qu’il fait de lui-même dans le Nouveau Testament. Car la raison humaine elle-même est déjà un lieu d’alliance, puisqu’elle est habitée par la Sagesse créatrice de Dieu. D’ailleurs, si l’être humain n’avait, par lui-même, aucune idée de Dieu, comment pourrait-il reconnaître son Interlocuteur qui lui adresse la parole dans les mots de la Bible ?
Toujours est-il que, au 13ème siècle, Thomas d’Aquin, prenant le relais d’Aristote, recueille dans sa réflexion l’Acte pur du Philosophe, en l’enrichissant par le donné biblique de la Création. Oui, Dieu met tout l’univers en mouvement (en acte) vers Lui mais c’est parce qu’Il est Lui-même à l’origine de cet univers ; à l’origine, singulièrement, du couple humain créé à son image et ressemblance. Si donc la Sagesse créatrice s’est imprimée en ces êtres d’esprit que sont les hommes, il convient que les hommes, réfléchissant sur eux-mêmes, soient capables de désigner leur Auteur, en suivant au plus près le processus dit de l’analogie.
Les voies de l’analogie
Dans un premier temps, on dira que toute beauté dans le monde doit trouver sa cause dans une Beauté infinie, de même toute bonté, toute vérité… Le ravissement qui saisit l’homme devant la splendeur d’un visage ou d’un paysage, l’émotion qui touche le cœur à la vue d’un geste de bienveillance, la paix que donne la contemplation de la vérité sont des mouvements qui conduisent l’âme plus loin que le donné sensible soumis à la corruption et à la mort : puisque ces merveilles existent, elles doivent leur origine à la Présence qui leur donne d’être.
Or, dans un deuxième temps, l’esprit doit s’avouer vaincu. L’homme, parce qu’il est lui-même fini et mortel, ne peut rien dire de cet Etre dont il a pressenti l’existence. Telle est la voie dite négative ou encore la théologie apophatique (c’est-à-dire incapable de parler), mettant la main à la bouche pour s’imposer le silence : qui es-tu, en effet, pauvre mortel, pour dire quoi que ce soit sur cette Réalité au-delà de laquelle il n’est pas possible de penser ? Ne faudrait-il pas, en effet, être Dieu soi-même pour énoncer un discours valable sur Dieu ?
Pourtant, ce temps de la négation – qui frôle toujours quelque peu l’athéisme – n’est pas le dernier moment de la démarche car si, malgré sa radicale finitude, l’esprit a conçu l’idée de Dieu, n’est-ce pas parce que Dieu lui-même était déjà présent à l’esprit de l’homme ? Telle est la voie que Thomas d’Aquin appelle d’éminence ; nous pourrions dire : de surcroît. En effet, quand l’esprit avoue sa limite, n’est-ce pas parce qu’il a déjà perçu l’au-delà de cette limite ? Sinon la limite ne lui serait pas apparue comme une limite, précisément…
Aujourd’hui
La preuve de l’existence de Dieu ne doit donc pas se présenter comme la démonstration d’un théorème de géométrie ou comme le résultat d’une expérience de physique : seule la réflexion philosophique, faisant retour sur l’expérience même de l’esprit humain, peut conduire à désigner cette Présence ineffable.
Mais quel intérêt, demandera-t-on, à vouloir penser Dieu aujourd’hui ?
Il est vrai que la philosophie contemporaine – à quelques belles exceptions près – n’est plus guère attirée par l’étude de ce Sujet, soit jugé trop invisible pour permettre de tenir sur Lui un discours vérifiable, soit devenu inutile puisque l’humanité a désormais pris en mains son propre destin, soit encore cruel dans son refus d’arrêter le mal et la souffrance qui abîment l’homme, soit tout simplement mort lui-même…
Pourtant, si un Etre transcendant hante l’esprit humain depuis ses origines les plus reculées et dans tous les espaces de la terre, ce n’est pas sans raison. Pour que l’humanité accède à sa propre vérité, ne doit-elle pas rester toujours en tension vers cette Altérité ? Sinon elle risquerait d’y perdre sa propre identité spirituelle et le fondement de son unité. N’est-ce pas, en effet, en cet Être mystérieux que se concentre l’énigme humaine ?
Déchiffrer l'énigme humaine (7) par X. Dijon s.j.
7. Pour (ne pas) conclure
Au fil de ses sept derniers numéros (décembre 2015-juin 2016), la revue Pastoralia a proposé à ses lecteurs une approche philosophique de l’énigme humaine, citant tour à tour Socrate, Bouddha, Platon, Aristote, les Stoïciens, Thomas d’Aquin, René Descartes, Blaise Pascal, Emmanuel Kant, Albert Camus, Jean Rostand ou Martin Heidegger…Mais fallait-il que la revue de l’Archidiocèse s’encombrât de telles réflexions profanes – même vulgarisées – alors que, d’habitude, ses articles concernent essentiellement la vie de l’Eglise ? Mais justement, les frontières de cette Eglise restent impossibles à tracer car, en finale, pour elle, c’est toujours de l’homme qu’il s’agit. Or la philosophie entend rejoindre l’homme avec les forces intellectuelles de l’homme.
Les guides
Nous l’avons noté au départ ; deux guides maladroits se sont présentés pour déchiffrer l’énigme humaine : d’un côté, le charbonnier suit aveuglément le discours de la foi puisque, dit-il, les mystères divins sont de toute façon obscurs et incompréhensibles, de l’autre côté, le savant (spécialiste des sciences naturelles ou des sciences humaines) met son point d’honneur à expliquer clairement ce qui se passe dans les corps, dans les esprits et dans les sociétés. Mais le risque est grand que ces approches, d’abord ne se rencontrent jamais, ensuite qu’elles révèlent l’une après l’autre leur insuffisance, puisque le scientiste récuse toute référence qui n’émane pas d’une quelconque discipline scientifique, tandis que le fidéiste répète son discours tombé du ciel sans chercher à l’articuler aux choses de la terre.
Face à ces deux discours que l’on peut qualifier de simplistes dans la mesure où ils prétendraient donner sur l’homme une réponse qui s’imposerait de l’extérieur, la philosophie comporte l’avantage de renvoyer l’homme à la propre question qu’il est à lui-même, en la maintenant toujours ouverte. Bien sûr, la science, elle aussi, laisse ouvert le champ de sa recherche. En effet, ses théories explicatives ne sont vraies que jusqu’au moment où un phénomène nouvellement découvert, résistant à ces explications, les falsifie, obligeant ainsi le chercheur à trouver une hypothèse originale qui rende un meilleur compte des observations faites. Mais cette ouverture du champ scientifique ne concerne encore que des données observables et mesurables ; la philosophie, par contre, soulève de l’intérieur la question proprement humaine.
Inlassablement le philosophe reprend la question qui porte sur lui-même : qui est-il, lui ? Enraciné dans la nature par toutes les attaches de sa chair, il cherche tout de même d’autres nourritures que celles des bêtes et d’autres lumières que celle du soleil. Que peut-il connaître de ce vaste monde où il a surgi sans l’avoir voulu ? Que peut-il espérer de cette vie qui connaîtra un terme ? En attendant, que faire ?
Les contributions précédentes ont montré que, dans sa quête intérieure, l’être humain est conduit plus loin que lui-même. Reprenons-en les diverses faces.
Le parcours
Voici l’homme nécessairement embarqué sur l’attelage disparate du corps et de l’âme, sans qu’il puisse se simplifier la vie en ne gardant qu’une des deux montures, du matérialisme ou de l’idéalisme. Car ce n’est que dans le lien à autrui (le Toi) qu’il verra se nouer la synthèse de cet étrange amalgame d’objectivité corporelle (le Il) et de subjectivité spirituelle (le Je).
Le voici encore, nécessairement aussi, coupé selon la différence des sexes : pourquoi ? N’est-ce pas pour que chacun des deux – homme et femme – trouve dans l’autre, par la parole libre conjointe à la chair imposée, la raison de son être propre ? Nouvelle preuve que l’essence humaine ne se laisse pas enclore dans une définition fermée : elle s’ouvre sur l’altérité.
Et puis, débordant la famille, voici l’homme engagé dans la société : une fois de plus, sa question doit rester ouverte, écartant les simplifications abusives, c’est-à-dire aussi bien de la pure liberté de l’individu sans lien d’humanité à autrui que de la massive égalité des sujets sans identité propre. C’est que, entre l’unique, qu’ils sont chacun en leur liberté, et l’universel, qu’ils sont tous en leur égalité, les humains connaissent une tension vitale qui ne se résout qu’en leur fraternité. Car seule leur ouverture fraternelle concilie la double exigence de leur être en corrélant l’une à l’autre la liberté et l’égalité.
Vient alors le mal, comme un coup de sabre sur le corps. Ici, l’énigme humaine s’épaissit jusqu’à devenir ténèbres. Pourquoi cette violence entre des humains que le cœur et la raison rendaient frères ? Pourquoi cet écart, qui fait tant souffrir, entre les idéaux auxquels aspirent les humains et les injures que leur inflige le réel ? L’homme, ici, se voit sommé de choisir une des branches de l’alternative : soit le repli sur l’évasion hors d’un monde si cruel ou sur la révolte contre l’absurdité du mal, soit le pari sur la possibilité de traverser l’épreuve en trouvant du sens à la souffrance qui fait craquer les limites de la personne. Mais où trouver ce sens qui maintiendrait l’homme dans l’ouverture à son avenir ? Serait-ce en Dieu ?
L’Autre de l’énigme
Les philosophes acceptent parfois d’entrer, d’ailleurs d’une autre manière que les théologiens, dans l’évocation de la Transcendance. C’est que l’énigme de l’homme est si peu saisissable qu’elle doit sans doute trouver son répondant au-delà de l’horizon seulement humain. Ici se manifeste le choix radical déjà sous-jacent à l’itinéraire parcouru jusqu’ici : si l’attelage du corps et de l’âme, ou la dualité de l’homme et de la femme, ou la tension de l’égalité et de la liberté, ou encore la traversée du mal par l’acceptation de la limite, forcent l’être humain à prolonger sa quête intérieure au-delà de lui-même, vers le tiers, vers l’alliance, vers la fraternité, vers le sens…, n’est-ce pas parce que, en sa racine, l’être humain est fondamentale ouverture à la Présence qui l’a voulu tel qu’il est ?
Bien sûr, l’homme reste libre de fermer cette possibilité en disant que la Présence en question n’a pas lieu d’être puisqu’elle est invisible, ou vide, ou dangereuse, ou humiliante, en tout cas inadéquate. Mais il est à craindre qu’une telle négation du mystère divin ne rejaillisse sur l’énigme humaine elle-même, en retirant à l’homme les clés de sa propre intelligence. Comment comprendre, en effet, l’âme et le corps en leur union disparate s’ils ne sont pas donnés l’un à l’autre par le Tiers qui est toute Simplicité ? De même l’alliance de l’homme et de la femme, et la fraternité qui tient ensemble l’immense diversité des hommes égaux et libres, s’ils n’ont pas de commun Père à leur origine et à leur fin ? Et même le mal qui scandalise : sinon, vers qui crier pour réclamer qu’il fasse sens ?
Certes, l’athée aurait bien des raisons à faire valoir pour justifier sa position, tant sont grands les malentendus qui persistent sur Dieu dans l’esprit des hommes. Mais rappelons-nous le mot de Blaise Pascal : « Athéisme, marque de force d’esprit, mais jusqu’à un certain degré seulement » (Pensées, Laf. 157). La force d’esprit ne consiste-t-elle pas à poursuivre l’exploration de l’énigme humaine jusqu’à y découvrir, dans l’étonnement proprement philosophique, la trace du mystère de Dieu ? Cet effort-là relève de la responsabilité de tous, des charbonniers et des savants, des athées et des lecteurs de Pastoralia. Car si tout être humain doit être laissé libre d’adhérer à la vérité, il est tenu de la chercher. Heureuse et douloureuse énigme de la condition humaine !